1985
Jean-François Lyotard et Jacob Rogozinski, L’Autre Journal, numéro 10
Par un chaud après-midi de juin, il rencontra sur le boulevard Saint-Michel le Babouin, son ancien prof de philo. Je voulais vous demander, Monsieur: que pensez-vous de la psychanalyse? Le Babouin se mit à rire: C’est une mode, qui passera. Ce qu’il y a de meilleur chez Freud, vous le trouvez déjà chez Platon. Pour le reste, ajouta-t-il d’un ton sans réplique, je vous dirai que je ne coupe pas dans ces fariboles. Vous feriez mieux de lire Spinoza. Lucien se sentit délivré d’un fardeau énorme. J’ai failli me perdre, pensa-t-il, mais ce qui m’a protégé, c’est ma santé morale.
Sartre, L’enfance d’un chef
Que les Lucien Fleurier de notre temps se rassurent, leur santé morale n’est plus en danger: le Babouin est de retour. Pendant plusieurs décennies, les sophistes anti-humanistes, les auto-phages cyniques et autres nihilistes romantiques avaient dominé la scène intellectuelle. Mais il semble que leur règne s’achève: depuis un an, une série de pamphlets vengeurs ont été commis, qui s’en prennent aux figures les plus marquantes de la pensée française des années 60, à Lacan, Foucault, Derrida, ou encore à Barthes et Blanchot.
Certes, leurs références ne sont pas toujours identiques, mais ce qui, malgré leurs divergences, les rassemble, c’est d’abord une visée commune, une même volonté de réagir contre les avancées les plus radicales de la modernité, d’en revenir aux dogmes et aux valeurs qui faisaient jadis les beaux jours de l’Université et des cénacles bien- pensants.

Tzevan Todorov, Critique de la critique, Seuil, 1985
Jacques Bouveresse, Le philosophe chez les autophages, Minuit, 1984, et Rationalité et cynisme, Minuit, 1985
Luc Ferry et Alain Renaut, la Pensée 68, Gallimard, 1985
C’est encore une certaine unité de style, un même refus de lire les textes, de se confronter à l’opacité singulière des œuvres. Au point que certains de ces rigoureux censeurs semblent ne connaître les œuvres critiquées que par ouï-dire. Ainsi, M. Bouveresse, qui part en guerre contre Deleuze, Foucault et Derrida, ne se réfère quasiment jamais à leurs écrits. Au lieu de s’expliquer directement avec Foucault, il commente Manfred Frank commentant Foucault. Et sa réfutation de Derrida consiste à accumuler des citations de Rorty ou de Searle discutant Derrida. Avec la même effronterie que le héros d’un roman d’Antonio Machado déclarant: Balzac est un auteur tellement insignifiant que je n’ai pas pris la peine de le lire.
A première vue, le récent livre de Ferry et Renaut paraît moins hâtif et superficiel. Aussi l’affairement journalistique s’est-il empressé de le saluer comme le signe du retour du sérieux philosophique (Libération du 22 Novembre 1985). A y regarder de plus près, on s’aperçoit pourtant que la polémique de bas-étage, l’insinuation calomnieuse et la réduction dogmatique y sont la règle. Tout cela au nom de la Vérité, du Débat démocratique et de la Rigueur morale …
On est généreux sur le contresens, parfois jusqu’au grandiose. Le lecteur apprendra par exemple que dans son exposé sur les Fins de l’homme, Derrida ne manquait pas d’appeler à une relève de l’humanisme (p. 19). Le texte incriminé tendait au contraire à remettre en question le motif d’une telle relève. Lacan n’est pas mieux loti: entre autres perles, on découvrira que, dans la pratique lacanienne de l’analyse, la sensiblerie humaniste n’est pas de mise: le moi doit être détruit, quoi qu’il en coûte (p. 261). Il y a une vingtaine d’années déjà, à des étudiants qui l’interrogeaient sur les moyens de faire sortir quelqu’un de sa conscience, Lacan rétorquait froidement: Je ne suis pas Alphonse Allais, qui vous répondrait: l’écorcher. Que riposterait-il aujourd’hui à ceux qui l’accusent de vouloir détruire le moi?
Cela dit, le trait le plus caractéristique de ce libelle serait à chercher dans son style: dans son ton grand seigneur qui évoque la morgue d’un Monsieur de Norpois raillant les chinoiseries de forme de Bergotte. On ironise sur les acrobaties verbales de Derrida (p. 39), sur son aptitude pour la production de variations littéraires sur un thème d’emprunt, simple et d’ailleurs assez pauvre (p. 185), avant de souligner dédaigneusement, pour conclure, l’extrême naïveté d’une telle tentative (p. 193) et l’ennui qu’elle inspire, analogue à celui qu’ont suscité en peinture certains avatars du cubisme. Ce n’est pas, on le voit, un livre qui se soucie d’analyser des œuvres ou de discuter des questions philosophiques. Il vise à exécuter ses adversaires, à les discréditer par tous les moyens, à les réduire à merci.
La critique criticiste (sic) à la Ferry-Renaut, c’est la police de la pensée.
Ils l’avouent du reste avec bonne humeur: leur seul but aura été d’identifier des positions et de dévoiler des contradictions, au risque d’être taxés de simplisme, d’amalgame (p. 288). On ne saurait mieux dire: identifier une position revient chez eux à réduire des œuvres diverses, hétérogènes, à l’identité abstraite d’un modèle ou d’un type idéal. Il devient alors très facile de dévoiler les contradictions de ce modèle.
Le premier procédé correspond à la technique policière éprouvée du portrait-robot. Nous désignerions volontiers la seconde comme la pratique de l’argument-matraque. Il s’agit d’asséner des objections si grossières et brutales qu’elles ne peuvent que méduser l’adversaire et lui interdire toute réplique digne de ce nom. On sait par exemple que les travaux de Derrida interrogent la conception traditionnelle de l’auteur et l’illusion d’une maîtrise du sujet sur le texte qu’il écrit. Allons donc! se récrient les madrés: puisque Derrida signe ses livres, c’est qu’il s’en considère comme l’auteur; par conséquent, il se contredit. CQFD (p. 194). Autre exemple: Heidegger met en garde contre la domination des valeurs dans la métaphysique moderne. Halte-là! c’est de l’amoralisme! Et d’ailleurs, si Heidegger est contre les valeurs, c’est bien la preuve qu’il évalue encore; donc, il se contredit, etc … Cet argument rustique plaît tant à Todorov qu’il s’empresse de l’appliquer au cas de Blanchot. Ce dernier ayant jadis appelé à libérer la pensée de la notion de valeur, le vertueux Trissotin s’en indigne et nous fait part de son effroi: nier les valeurs, c’est là du nihilisme, c’est faire primer la force au détriment du droit (cf. Critique de la critique, p. 71-74). Et puisqu’il paraît que la littérature est un discours orienté vers la vérité et la morale (sic: p. 189), et que le rapport aux valeurs lui est inhérent, il faut en conclure que l’idéologie relativiste et obscurantiste de Blanchot se contredit et manque gravement à sa fin …
Si l’on voulait répondre à de telles inepties, de longues explications seraient à chaque fois nécessaires. Contre la confusion naïve de l’éthique et des valeurs, il faudrait au moins se référer à Kant, pour montrer que l’impératif catégorique, en tant qu’il manifeste une obligation inconditionnée, ne se laisse jamais réduire à des valeurs déterminées, c’est-à-dire aux préférences des sujets empiriques. C’est en ce sens qu’il importe de délivrer la pensée de l’emprise des valeurs, non pas pour la vouer au nihilisme, mais pour l’ouvrir à la dimension la plus radicale de l’éthique -celle qui se trouve sans doute impliquée, aussi, dans le risque d’écriture. Mais la fonction des arguments-matraques est précisément de couper court à toute velléité d’analyse.

1977, Bernard-Henry Levy
Les Nouveaux Philosophes: Épousailles du Capital, des Mass-Médias et de l’Université
La pensée de Kant est un enjeu trop important pour être abandonnée aux néo-kantiens. Aussi abstrait qu’il puisse paraître, le conflit actuel sur l’interprétation de Kant engage en effet des questions décisives. Soit, par exemple, la pièce maîtresse du pamphlet de Ferry-Renaut, l’accusation d’anti-humanisme. La portée du débat est considérable: il s’agit des droits de l’homme, et des conditions de leur légitimation philosophique. Selon eux, la visée fondamentale de la pensée française récente réside clairement dans le projet de mener une critique radicale de la subjectivité (p. 41); en choisissant, à la suite de Heidegger, le parti de l’anti-humanisme, les philosophes des sixties auraient ôté tout sens à la notion des droits de l’homme. Ceux-ci exigeraient en effet d’être fondés sur une Idée de l’Homme, du Sujet libre et autonome: sur cet humanisme non-métaphysique que nos censeurs croient trouver chez Kant et Fichte. Lorsqu’un anti-humaniste comme Foucault ou un heideggerien comme Lefort milite pour les droits des prisonniers ou soutient le combat de Solidarnosc, il se condamnerait à l’incohérence. Il faut adhérer à l’humanisme Ferry-Renaut pour avoir le droit de s’intéresser aux hommes.
Là encore, devant tant de présomption, l’analyse serait nécessaire. Il faudrait notamment montrer la confusion qui s’opère ici entre la pensée du sujet et la valorisation de l’homme (p. 22) et qui permet d’assimiler toute mise en question de l’humanisme métaphysique à une destruction de la subjectivité. Si les paladins de l’Homme avaient pris la peine de lire Husserl, ils y auraient découvert une tentative rigoureuse pour penser la subjectivité en mettant hors-jeu -en réduisant- toutes les déterminations empiriques de la personne humaine. Au terme de cette neutralisation, Husserl peut affirmer que Moi, ce n’est plus l’Homme, que l’Ego pur n’a rien d’humain, qu’il doit être décrit sans aucune référence à l’existence collective, à la psychologie, ni même au langage des hommes.
Or, malgré la différence des problématiques, la démarche de Husserl est sur ce point apparentée à celle de Kant. Lorsque celui-ci se propose de situer le principe du devoir moral, il souligne qu’il est de la plus haute importance de ne pas chercher à dériver la réalité de ce principe de la constitution particulière de la nature humaine. C’est seulement sous cette condition qu’il est possible, selon Kant, de garantir la pureté de l’éthique, qui ne doit être mélangée ni d’anthropologie ni de théologie. Kant y revient sans cesse, l’Homme n’est pas le destinataire de l’impératif catégorique: ce dernier s’adresse à tous les êtres raisonnables finis. Comme principe pur de la raison pratique, la Loi morale est, au sens strict, inhumaine.

Ce que nous prescrit l’impératif, c’est de transcender notre humanité empirique, et ce que Kant nomme une volonté pathologiquement affectée; de nous émanciper des limites de notre situation historique, de nos penchants psychologiques, de nos valeurs humaines, trop humaines, afin de pouvoir accueillir sans réserve l’appel de la Loi. Et lorsque Kant tentera, à partir de 1792, de réinscrire les principes éthiques dans le donné empirique de l’existence humaine, l’humanité lui apparaîtra infiniment coupable, vouée à un mal radical. Ce qu’il y a d’humain dans l’Homme, ce serait cet écart, cette torsion fautive qui nous détourne de la Loi.
Quand Ferry et Renaut se réclament de l’humanisme kantien pour condamner ceux qui veulent rendre la philosophie inhumaine, ils ne comprennent rien à Kant. La pensée de Kant n’est pas un humanisme (ni un rationalisme, d’ailleurs). Elle n’est pas davantage un antihumanisme. D’abord parce qu’aucune pensée authentique, pas plus celle de Kant que celle de Husserl ou de Heidegger, ne se laisse enfermer dans ces oppositions scolaires. Mais aussi parce que la neutralisation de toute donnée anthropologique est requise pour conférer leur sens aux droits de l’homme. Dans la perspective de Kant, ce qui donne droit aux droits de l’homme, ce qui garantit leur caractère universel, inconditionné -qui fait défaut aux droits et aux privilèges des communautés empiriques- c’est leur déduction à partir de l’impératif éthique, comme mode de donation extérieur de la Loi. Afin de légitimer les droits de l’homme, il aura fallu dégager l’instance in-humaine de la Loi, faire son droit à l’inhumain.
De ce point de vue, l’Homme n’est jamais, pour Kant, le pur sujet du Droit. La naïveté des humanistes, et leur dogmatisme, consiste à vouloir fonder les droits de l’homme sur un concept déterminé, voire sur une Idée de l’Homme, défini comme personnalité autonome et raisonnable, etc … Comme si cette entité, l’Homme, pouvait être érigée en référent ultime du droit, et permettait ainsi d’assigner, une fois pour toutes, les normes du juste et de l’injuste, de l’humain et de l’inhumain. Nous pensons au contraire que la dynamique de ces normes consiste à les exposer au jeu d’une indétermination radicale, au risque du conflit, du différend. Cela interdit à tout sujet déterminé -individu, classe, nation ou même humanité empirique- de se poser en auteur souverain ou en référant suprême du droit.
Déterminer a priori le contenu des droits de l’homme implique de les figer arbitrairement, d’empêcher toute remise en question des règles établies, toute recherche de règles nouvelles. De couper court à toute querelle au sujet du juste et de l’injuste. Ce qui revient à proscrire le différend. Nos censeurs, d’ailleurs, n’en font pas mystère. Faire régner l’ordre, l’uniformité, le consensus, soumettre chaque singularité à une norme commune- telle est la mission que s’est assignée la police de la pensée.
Et l’on ne s’étonnera pas de voir cette molle idéologie du consensus virer, sous la plume policière de M. Bouveresse, à une apologie sans nuances du conformisme de masse. Que prétend-il nous imposer, comme règle majeure et comme fin ultime? Le consensus et la solidarité qui se manifestent dans le respect d’institutions, de règles et de normes acceptées sans protestation (sic), la rationalité vulgaire, le langage ordinaire, le sens commun linguistique, la compréhension usuelle, l’usage quotidien … La police du langage, le maintien de l’ordre dans les échanges linguistiques, la préservation du consensus, de l’uniformité et de la régularité indispensables à l’existence même d’une communauté (p. 132). Le moment est bien venu de remettre au pas les récalcitrants, ces marginaux et ces zombies stigmatisés par Ferry et Renaut, tous ceux qui refuseraient encore de se plier à la loi des échanges harmonisés et pacifiés (Bouveresse, p. 148) et de s’identifier aux intérêts supérieurs de leur communauté historique (p. 159).
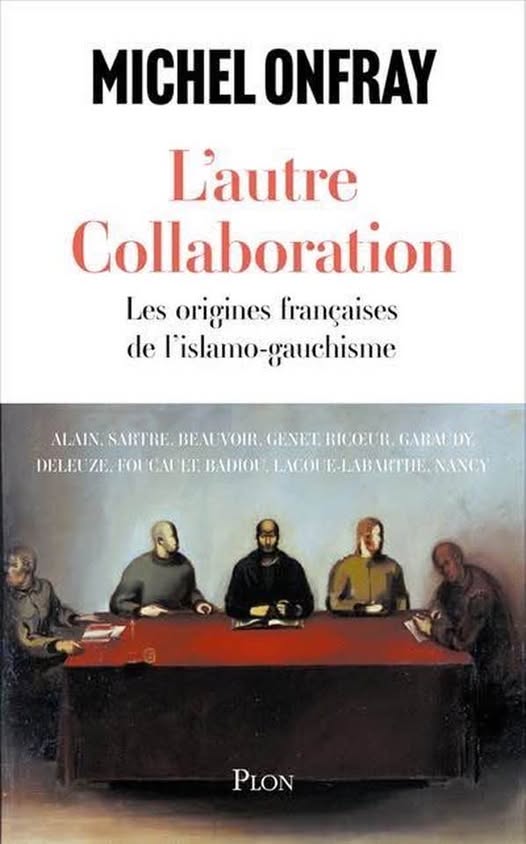
2025, dernière étape: le babouin a muté
50 ans après l’appel de Bouveresse à la police de la pensée celle-ci est devenue bouffonne -et d’autant plus terrifiante, vraiment fasciste.
Faut-il évoquer les crises des fondements, les paradoxes logiques, les apories, où la pensée, périodiquement, se ressource? Autant avouer, répliquent les pacificateurs, que vous prônez la guerre civile généralisée (Bouveresse, p. 145), la disparition de la communication (Ferry-Renaut, p. 45), c’est-à-dire la barbarie et la terreur. Ce qui est terroriste pourtant, au sens de la terreur ordinaire de nos sociétés modernes, n’est-ce pas plutôt leur peur du désordre et leur haine de l’événement, leur besoin de normaliser et d’identifier? Ce qui nous menace, n’est-ce pas cette certitude arrogante que tout est présentable, déterminable, communicable? Mais les bons apôtres ne s’embarrassent pas de subtilités: dès que l’on met en doute la possibilité d’une communication transparente, d’un accord unanime fondé en raison, on désire la violence et le chaos.
Un certain Kant nous avait cependant appris à nous méfier de ces alternatives sommaires. En exposant, dans la Critique du jugement, l’antinomie du jugement esthétique, il constatait qu’en matière de goût on ne peut guère disputer, c’est-à- dire démontrer au moyen de concepts déterminés et que l’on ne saurait ainsi parvenir à un consensus stable. Mais qu’il reste néanmoins possible de discuter, d’en appeler à l’assentiment d’autrui, sans être jamais assuré de convaincre. En effet, dans ce genre de jugement, notre faculté de juger n’est pas déterminante mais seulement réfléchissante. Elle ne se fonde pas sur une catégorie ou un principe universel déjà donné qu’il n’y aurait plus qu’à appliquer, mais il lui faut, sous le coup d’une donne singulière, d’un cas inattendu, juger sans règle afin d’établir la règle. De cet usage réfléchissant du jugement procède l’activité de l’artiste, du philosophe critique, du politique républicain et toute démarche inventive qui, sur la trace de l’inconnu, de l’inacceptable, brise avec les normes constituées, fait éclater les consensus, ravive le sens du différend.
C’est évidemment ce que ne supporte pas le néo-kantien dogmatique, toujours soucieux de restaurer l’unité et l’identité. Aussi s’empresse-t-il de dénaturer la théorie kantienne du jugement réfléchissant, en l’interprétant comme une conciliation du particulier (de la sensibilité) et de l’universel (du concept) où le réel particulier se réconcilie librement avec l’universel. Ferry croit pouvoir en conclure que la communication esthétique apparaît comme communication directe, comme source d’une intersubjectivité immédiate: les individus s’y trouvent réconciliés sans l’intermédiaire d’un concept (Philosophie politique I, p. 178-179). Il lui suffit alors de transposer ce modèle du plan esthétique au plan politique pour déterminer le politique comme espace d’interaction et de communication et justifier les idéologies de consensus.

Atelier de Botticelli, Augustin sur la plage
Quelle facette de sa propre personnalité le philosophe aimait-il retrouver dans le miroir du Père de l’Église? La publication de La Confession d’Augustin, ouvrage posthume et inachevé (Lyotard est mort, à 72 ans, des suites d’une leucémie), apporte quelques bribes de réponse. La raison de cet intense compagnonnage remonterait-elle aussi loin que son adolescence, quand, tenté par le sacerdoce, Lyotard fit une retraite dans un monastère dominicain? Ou faudrait-il chercher du côté de son séjour, comme enseignant, en Algérie dans les années 50, sur le sol même qu’avait foulé Augustin? Ne serait-ce pas plutôt la modernité du nouveau pli que le saint fait prendre au souci de soi des anciens, de l’extériorité civique à l’intériorité de l’âme qui retiendrait le philosophe postmoderne?
On a sans doute affaire ici au plus grave des contresens commis par les néo-kantiens. Certes, dans sa requête d’universel, chaque jugement esthétique porte selon Kant la promesse d’une communauté idéale, où mon sentiment singulier sera aussi celui de tous. Mais, précisément parce qu’il est immédiat, qu’il s’opère sans la médiation d’aucun concept, le jugement esthétique ne peut revendiquer qu’une universalité subjective. C’est pourquoi, ajoute Kant, il se trouve si souvent repoussé dans sa prétention à l’universalité Tel est le drame du jugement esthétique, incapable d’argumenter sa règle ou sa norme, et voué à invoquer un accord idéal au moment même l’avis des autres le récuse en fait.
Loin de permettre une communication directe, l’exercice du jugement réfléchissant éveille plutôt le sentiment d’une communauté promise et toujours différée. Et ce trouble du sens commun s’aggrave avec le sentiment du sublime, qui atteste de l’imprésentable, de l’excès incommensurable de l’Idée sur réel. La communauté s’y distend alors jusqu’à ne plus tenir qu’au fil de l’Idée de notre destination. Parce qu’elle est promesse, la communauté demeure hors d’atteinte, comme un horizon. Qu’une telle communauté arrive néanmoins à s’esquisser, que nos sentiments puissent être parfois partagés, c’est là, dit Kant, un fait étrange et singulier qui fait toute l’énigme de notre faculté de juger. Ententes précaires, accords mineurs nés d’un coup du sort et qui ne sauraient sceller aucune réconciliation. Mais nous appeler au partage du différend.
De ces occasions imprévues que nous accorde l’événement, l’enthousiasme suscité par la Révolution française a représenté pour Kant un exemple éminent. C’est qu’il décelait le signe historique d’une disposition morale de l’humanité et l’indice d’un progrès vers la fin ultime de notre espèce. Si nos sentiments sur ce sujet ne sont plus les mêmes que ceux de Kant c’est sans doute que nous sommes confrontés une pluralité de signes d’histoire – qu’évoque dans leur hétérogénéité les noms d’Auschwitz de la Kolyma, de Budapest 1956 et aussi de Mai 68, dont chacun accuse à manière la dispersion des fins, la fuite ou le déclin des Idées établies par les Lumières, et requiert une autre écoute, à d’autres Idées.